Un domaine public payant ? L’oxymore proposé par Victor Hugo
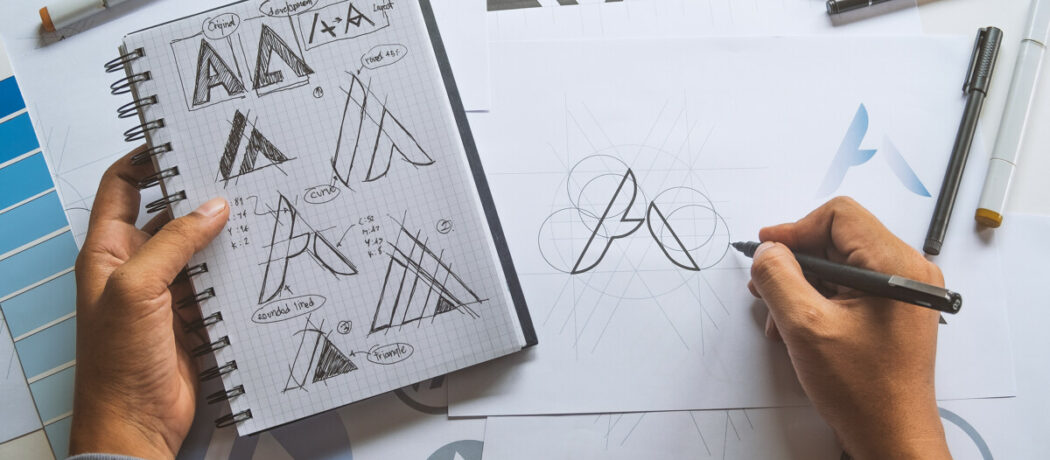
Partage
Pour la plupart des lecteurs, parler de « domaine public payant » contiendra une forme de contradiction. Quand on parle de domaine public, tout le monde suppose qu’il est gratuit. Les œuvres qui en font partie peuvent a priori être librement exploitées sans requérir l’autorisation ou payer des indemnités à l’auteur ou à ses ayants droit.
En droit de la propriété intellectuelle, il faut en fait distinguer les droits moraux des droits patrimoniaux. Ces derniers concernent le fait de pouvoir tirer une rémunération de son œuvre. L’auteur en dispose toute sa vie et, dans de nombreux pays, jusque 70 ans après sa mort pour ses ayants droit sauf cas particulier. L’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry par exemple, peut désormais être exploitée librement en Belgique (le crash de son avion, abattu par un chasseur allemand, a eu lieu en juillet 1944), mais, car « mort pour la patrie », une prorogation fait qu’il faudra en France attendre 2032. Ce sont ces droits-là qui tombent dans le domaine public. Les droits moraux, qui englobent le respect du nom de l’auteur et de la qualité de son œuvre, ne s’éteignent, eux, jamais.
Dans presque tous les pays développés, y compris la France et les États-Unis, le domaine public est donc gratuit. Il existe cependant une poignée de pays en développement en Amérique latine et en Afrique francophone où ce n’est pas le cas. L’idée avait été défendue en particulier par Victor Hugo, dont nous avons retracé le cheminement dans un article récent et dont nous montrons les différences avec les modèles actuellement en place.
Un rapport de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle publié en 2010 répertorie les États qui disposent d’un domaine public payant : il s’agit de l’Algérie, du Kenya, du Rwanda, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, et du Paraguay. Il faut y ajouter deux pays qu’omet le rapport : l’Argentine et l’Uruguay sous ce régime depuis respectivement 1958 et 1937.
Dans ces pays, il y faut, pour exploiter une œuvre entrée dans le domaine public, payer une taxe à l’État. Cela vaut tant pour rééditer des œuvres dont le droit d’auteur a expiré, que pour celles qui n’ en ont jamais eu. Et peu importe la nationalité du créateur : réimprimer au Paraguay des œuvres complètes de Rabelais requiert le paiement d’une taxe. À la discrétion de l’organisme qui administre le système, les bénéfices peuvent aussi être reversés sous la forme de bourses, de subventions et d’aides aux auteurs nationaux.
Un système opaque
En Argentine, pays objet de certains de nos travaux, le domaine public payant a été instauré autoritairement en 1958 (le parlement avait alors été dissous). Le Fondo Nacional de las Artes, l’autorité chargée de l’application du domaine public payant en Argentine) déclare ce qui suit :
« L’utilisation d’une œuvre est un concept large, qui comprend son édition, sa reproduction, sa représentation, son exécution, sa traduction et son adaptation. Ainsi, une station de radio qui passe “El día que me quieras” de Gardel et Le Pera doit payer la redevance, qu’il s’agisse de la chanson originale ou d’une version ; la reproduction d’un film comme “Frozen” de Disney doit également payer, puisque son histoire est une adaptation de “La Reine des neiges” de Hans Christian Andersen ; et l’utilisation d’une œuvre comme “La Création d’Adam” de Michel-Ange dans un jeu vidéo, également. »
Le champ d’application de la taxe sur le domaine public a de plus été étendu, l’an passé, aux œuvres dans l’environnement numérique.
Comme nous le démontrons, en rendant les accès plus coûteux, la chose porte préjudice aux consommateurs d’œuvres culturelles et aux artistes qui veulent les adapter ou les modifier. On ignore de plus quelle part de l’argent collecté est effectivement distribuée à les bénéficiaires visés par la loi, et selon quels critères la répartition est opérée. La décision est prise en effet par un organisme d’État à huis clos. Si l’on se fie à la documentation comptable consultée, ce qui est effectivement redistribué aux auteurs nationaux ne dépasse pas un quart de ce qui est collecté. Cela semble peu par rapport aux barrières posées.
Le domaine public payant, tel qu’il s’applique aujourd’hui, est « successif ». C’est-à-dire qu’il commence après l’expiration de la durée post-mortem du droit d’auteur pour les héritiers, ce qui se distingue fortement du domaine public payant « immédiat » qu’imaginait Victor Hugo au XIXe siècle.
Une « bizarre invention de législateurs ignorants » ?
Victor Hugo n’est, en fait, pas tout à fait le père intellectuel de la notion. L’idée originale reviendrait à Pierre-Jules Hetzel, républicain qui comme l’auteur des Misérables a choisi l’exil en 1852. C’est depuis Bruxelles qu’il avait publié un livre à ce sujet en 1858, la propriété littéraire et le domaine public payant, réimprimé à Paris en 1862. On doit néanmoins à Hugo de l’avoir fait connaître, grâce notamment à deux célèbres discours prononcés au Congrès littéraire international de juin 1878 qui a eu lieu à Paris.
À cette époque, il existait en France un système de propriété intellectuelle qui accordait des droits économiques et moraux absolus à l’auteur pendant sa vie. Après la mort de l’auteur, elle était transférée à ses héritiers pour une durée limitée, similaire à l’actuel droit d’auteur, bien que plus courte.
Hugo voulait remplacer cette protection post-mortem auctoris, qu’il considérait comme une « capricieuse et bizarre invention de législateurs ignorants », par un domaine public payant immédiat. Celui-ci profiterait à la fois à la société, au reste de la communauté des auteurs et même aux héritiers. Pour lui, il était inconcevable que quelqu’un qui n’avait pas contribué à la création de l’œuvre puisse décider de son sort, comme le fait de la publier ou non, chez quel éditeur et à quel prix.
Les écrits de Hugo et Hetzel, mais aussi le droit comparé et les expériences étrangères, pourraient servir d’inspiration à la France, où l’idée de l’introduction d’un domaine public payant réapparaît constamment.
En 2008, les éditeurs indépendants de France, représentés par L’autre Livre, ont suggéré la création d’une taxe pour les impressions d’œuvres tombées dans le domaine public pour « sauver » le marché des livres indépendants (proposition n°9). Une étude commandée par LeMOTif, observatoire des habitudes de lecture et du marché du livre français, a cependant conclu que pareil prélèvement s’avèrerait inefficace. Le rapport dit « Zelnick » financé par le ministère français de la Culture et de la Communication en 2010 a lui plaidé pour la création d’une taxe sur les films pour financer la numérisation et la préservation du patrimoine cinématographique français.
Renforcer la gratuité, éviter les abus
Plus récemment, la France insoumise relançait le débat en parlant de « socialisation » du domaine public. Ses représentants ont présenté deux propositions de loi sur le sujet, mais sans succès.
Il semble qu’une telle « socialisation » aurait en pratique pour effet de limiter l’accès aux œuvres dans le domaine public. Plutôt que de taxer, au regard de ce qui se fait au-delà de nos frontières, il semble qu’il vaudrait mieux au contraire renforcer la gratuité, tout en offrant des protections contre les abus comme le propose le rapport Lescure de 2013 (propositions 74 et 75) :
« Renforcer la protection du domaine public dans l’univers numérique : établir dans le code de la propriété intellectuelle une définition positive du domaine public ; indiquer que les reproductions fidèles d’œuvres du domaine public appartiennent aussi au domaine public, et affirmer la prééminence du domaine public sur les droits connexes. Valoriser le domaine public numérique sans en restreindre la diffusion : encadrer les exclusivités prévues dans les partenariats public – privé de numérisation ; encourager des politiques de valorisation fondées sur l’éditorialisation et sur les services à valeur ajoutée. »
Si à un droit d’auteur post-mortem à la durée déjà longue succède une taxe perpétuelle sur le domaine public, ce serait entraver l’accès à la culture, rendre plus coûteux l’usage des œuvres de l’esprit par les citoyens, ajouter des barrières supplémentaires pour la création d’œuvres dérivées telles que les adaptations, anthologies, colorisations de vieux films ou documentaires contenant des images d’archive. Les expériences d’autres pays montrent aussi que cela ne favorise pas la circulation des œuvres en format numérique.
Remplacer les droits post-mortem par un domaine public payant immédiat, comme le proposait Hugo, serait une autre affaire. La proposition de Hugo visait à équilibrer les intérêts de la société, des auteurs et de leurs héritiers. Aujourd’hui cela se heurterait cependant au régime international du droit d’auteur : la proposition serait contraire à tous les traités internationaux sur le sujet et au droit communautaire. Depuis la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886, le droit d’auteur a, en effet, pris une autre direction, celle du maintien de droits exclusifs post-mortem pour des périodes de plus en plus longues.
Maximiliano Marzetti, Assistant Professor of Law, IÉSEG School of Management
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.



