Néonicotinoïdes, un débat qui réduit la nature à sa valeur financière

Partage
Ce printemps 2021 a été marqué par le retour dans les champs de betteraves des insecticides à base de néonicotinoïdes. Après 20 ans de débats, ils avaient été interdits en France en 2016 (pour une application en 2018), avant de l’être également dans l’Union européenne en 2018.
Ce rétropédalage correspond en fait à une dérogation temporaire accordée aux betteraviers pour lutter contre une invasion de pucerons vecteurs de la jaunisse, maladie qui décime les plants. Cette autorisation a été arrachée après une année d’intenses controverses entre les partisans du texte (syndicats agricoles et industries d’agrochimie notamment) et ses opposants (apiculteurs, associations de défense de l’environnement).
Jusqu’à leur interdiction, les néonicotinoïdes étaient largement utilisés par l’agriculture contre les insectes nuisibles. Ces molécules attaquent le système nerveux des insectes, entraînant une paralysie mortelle. Leur nocivité sur les pollinisateurs, les petits vertébrés, les oiseaux et la faune aquatique a été démontrée. Pour l’homme, ils sont suspectés d’être cancérogènes et neurotoxiques.
Comment s’explique ce revirement de la part du gouvernement français ? L’affaire a suscité de vives querelles. Au cœur de ce débat emblématique entre impératifs économiques et urgence environnementale, les deux camps ont mobilisé des valorisations financières (l’expression de valeurs en termes financiers) comme fer de lance de leurs revendications. Quels sont leurs arguments ?
L’impact économique des pucerons
L’argument principal avancé par les partisans de la dérogation porte sur la perte de rendement, estimée de 30 % à 50 %, provoquée par l’interdiction des néonicotinoïdes. Les pertes financières associées ont quant à elles été évaluées entre 150 et 200 millions d’euros au total et jusqu’à 1 000€ par hectare.
Au-delà des pertes immédiates, les défenseurs invoquent la souveraineté alimentaire française et l’économie du pays. Cette baisse des rendements intervient dans un contexte de fragilisation de la filière à la suite de la fin des quotas européens et la chute du cours du sucre. Son effondrement ferait disparaître les emplois locaux (45 000 emplois directs) tout en imposant l’importation de produits dérivés (sucre, éthanol).
Les arguments sont principalement économiques : ils s’appuient sur une marchandisation de la nature, soit une causalité entre éléments naturels et revenus financiers. Cette marchandisation repose sur deux mécanismes.
Le rendement pour quantifier la nature
D’abord, la nature est quantifiée à travers le rendement. Clef de voûte de l’argumentaire des partisans, celui-ci traduit les éléments naturels (surface de terre) en quantités (kilogrammes de betteraves).
Cet indicateur suppose certaines limites : il s’inscrit dans un horizon temporel de court terme car les rendements ne se rapportent qu’à une année et les prévisions ne portent pas au-delà. Il ne peut faire sens que par rapport à une valeur de référence, ici historique, fondée sur les résultats passés (souvent une moyenne quinquennale).
La référence historique implique un objectif de maintien (voire d’amélioration) de la performance dans le temps. D’autres références, tirées du benchmark (comparaison avec les parcelles les moins touchées par la jaunisse) ou théoriques (rendement estimé possible compte tenu des conditions), auraient pu mener à des interprétations différentes.
Le rendement est également un indicateur global, c’est-à-dire qu’il agrège des facteurs variés en un seul nombre et gomme les variations telles que les rendements locaux ou les circonstances météorologiques.
Enfin, il est exclusivement quantitatif. Il ne prend en compte aucun aspect qualitatif, tel que la qualité du sol, des betteraves ou la biodiversité existante.
Ainsi, les néonicotinoïdes, qui interviennent dans ce mécanisme de quantification en diminuant le rendement, altèrent le lien de causalité entre surface et quantité produite.
Les revenus financiers pour monétiser la nature
Ensuite, un mécanisme de monétisation permet de traduire cette quantité en revenus financiers. Ce mécanisme dépend notamment du prix du marché et de la concurrence internationale.
Cependant, dans le calcul du bénéfice économique, cette valorisation ignore certains coûts comme celui de la destruction de biodiversité ou celui de la pollution.
La nocivité environnementale des néonicotinoïdes
Les adversaires de la dérogation opposent à ses partisans les études scientifiques démontrant la nocivité des néonicotinoïdes, les associant au déclin des pollinisateurs.
Le taux de mortalité des abeilles peut en effet atteindre 30 % après la floraison de plantes traitées (contre 5 % en temps normal) tandis que, au global, trois cent mille ruches disparaissent chaque année.
Ils rappellent l’urgence liée à l’effondrement de la biodiversité et exhortent à transformer la situation en opportunité de penser une autre agriculture.
La valeur économique de la pollinisation
En miroir de la partie adverse, ils mobilisent le langage économique. Ainsi, la pollinisation par les insectes est évaluée à 14,6 milliards d’euros. La Fondation Nicolas Hulot avance que l’extinction des abeilles coûterait 2,9 milliards d’euros à la France, contre les 100 millions alloués pour le soutien aux betteraviers.
Les opposants à la dérogation affirment donc que la pollinisation gratuite des cultures est plus profitable que l’emploi d’insecticides (jusqu’à 200€ par hectare).
La perte de la biodiversité est la valorisation clef dans ce raisonnement : en donnant à l’environnement une valeur économique, sa destruction se transforme en coût et entre dans le discours médiatique et politique. L’existence d’espèces à l’état naturel est valorisée par le service de pollinisation rendu à l’humain, ce qui suppose là aussi une causalité entre nature et bénéfice économique.
Au-delà de la valeur financière
Cette valorisation s’inscrit dans un horizon temporel de long terme : le déclin des populations, ici des abeilles, se répercute sur plusieurs générations, aussi ses conséquences ne sont pas mesurables sur une année.
Elle est par ailleurs financière : d’autres définitions de la valeur sont possibles, telles que la valeur morale de la protection des espèces, leur valeur esthétique ou leur contribution au bien-être individuel.
La valeur financière permet de parler un langage néolibéral plus légitime dans le débat public. Elle suppose que la valeur d’une espèce dépend de son degré d’utilité pour l’humain, ici par la pollinisation.
Cet angle néglige la valeur intrinsèque des espèces et leur participation à l’équilibre des écosystèmes. Elle implique que l’utilité de l’espèce à l’humain est connue et mesurable.
Ainsi, l’environnement devient un actif, générant des revenus présents et futurs. Sa destruction entraîne non seulement la diminution de la valeur de l’actif mais également des bénéfices futurs, voire des coûts de remplacement s’il est nécessaire à l’activité humaine.
D’autres aspects du débat rendus invisibles
Les valorisations au cœur des arguments des deux camps ont centré le débat sur l’enjeu économique de l’interdiction des néonicotinoïdes. Loin d’être neutres, ces valorisations rendent (in)visibles certaines composantes du débat.
Dans les deux cas, elles présentent la nature comme un capital économique et orientent la discussion sur l’importance des bénéfices résultant de son exploitation. A contrario, elles masquent ses facettes qualitatives et morales.
Malgré ces fondations communes, les deux valorisations étudiées révèlent des priorités sous-jacentes radicalement différentes. À travers le rendement, les partisans mettent l’accent sur les intérêts sociaux et économiques, soulignant les pertes dans un cadre temporel de court terme.
Les détracteurs avancent des préoccupations environnementales en valorisant les bénéfices générés sur le long terme et le coût de destruction. De ce fait, ces valorisations sont symptomatiques de modèles divergents qui sont en réalité difficilement opposables directement.
Marion Ligonie & Sarah Maire, IÉSEG School of Management.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Contributeurs
Suggestions d'articles ou vidéos

RSE, Durabilité & Diversité
Pourquoi la mise en œuvre de la durabilité échoue souvent, même quand tout le monde est d’accord
18/02/2026
4 min
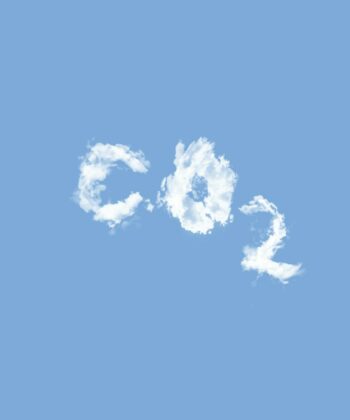
Économie & Finance
En bref : comment le système d’échange de quotas d’émission de l’UE transforme le marché du travail
15/01/2026
4 min

Économie & Finance
Le marché du carbone européen a-t-il vraiment réduit les émissions du secteur électrique ?
22/12/2025
5 min

Management & Société
Managers : comment transformer la diversité en un avantage concurrentiel ?
15/12/2025
3 min






